Améliorer les radiothérapies, des essais cliniques à l'adaptation des soins
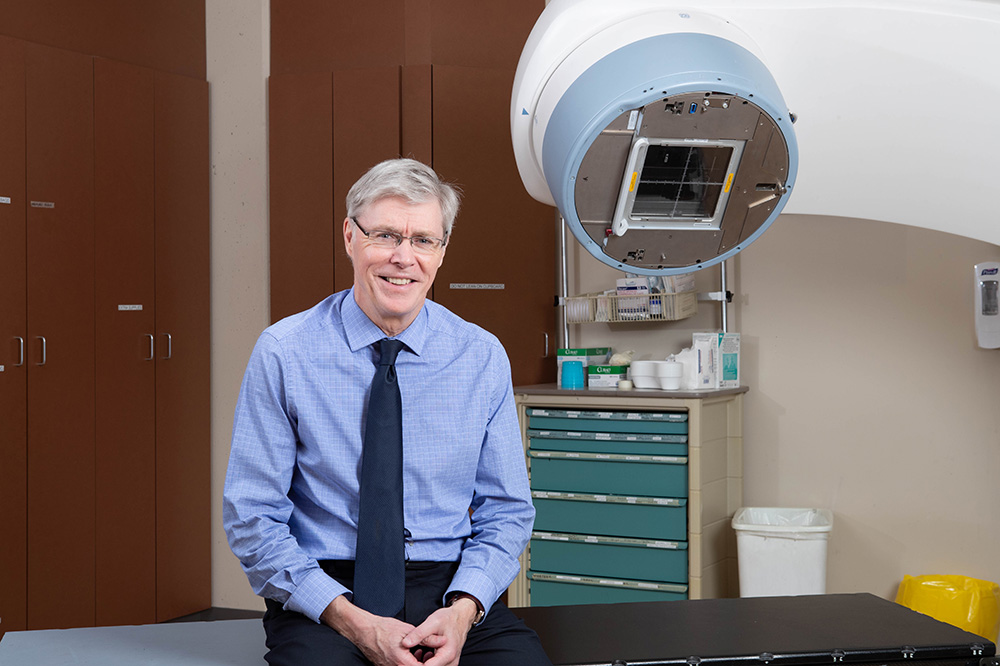
Environ 70 % des patientes aux prises avec un cancer du sein subissent une radiothérapie. Au stade précoce, le traitement est généralement administré à l'issue d'une chirurgie mammaire conservatrice afin de réduire le risque de récidive et d'éviter l'ablation du sein. Grâce à des chercheurs comme le Dr Tim Whelan, radio-oncologue à l'Université McMaster, les protocoles de soins en radiothérapie ont considérablement progressé, tant au Canada que dans le reste du monde.
Il y a quarante ans, alors que le Dr Whelan entamait sa carrière de chercheur, les traitements du cancer du sein par radiothérapie manquaient de rigueur et de précision. Des effets indésirables comme l'inflammation de la peau, la douleur, le gonflement du sein et des séquelles esthétiques durables nuisaient alors grandement à la qualité de vie des patientes.
Résolu à améliorer les pratiques cliniques ainsi que l'efficacité et le caractère sécuritaire de la radiothérapie pour les patientes, le Dr Whelan s'est embarqué dans un long périple jalonné d'avancées marquantes. Dans les années 1990, l'une de ses premières études sur la prévention des récidives de cancer du sein démontrait déjà qu'une forte dose quotidienne d'irradiation pendant trois semaines était non seulement aussi efficace que le traitement de cinq semaines qui prévalait jusqu'alors, mais induisait en outre moins d'effets secondaires.
En 2000, dans le cadre d'une Chaire de recherche du Canada appuyée par l'Initiative canadienne sur le cancer du sein et la Société canadienne du cancer, le Dr Whelan a entrepris une étude (en anglais seulement) consistant à évaluer l'efficacité d'une radiothérapie ciblant les aires périphériques dans les cas de cancers du sein s'étendant aux ganglions axillaires. Elle révélait qu'après une chirurgie conservatrice, l'irradiation des ganglions lymphatiques, en complément d'une irradiation du sein complet, entraînait une réduction du risque de récidive et de propagation du cancer. L'équipe du Dr Whelan avertissait toutefois que les bénéfices de cette approche pour les patientes touchées par un cancer du sein à faible risque étaient incertains, suggérant que ce groupe pouvait potentiellement être exempté.
L'essai M.039 (en anglais seulement), que mènent actuellement le Dr Whelan et des collaborateurs des États-Unis, vise précisément à approfondir la question. Financé par les IRSC, l'essai a pour objectif de mettre en évidence des indicateurs quantifiables pour repérer les patientes qui n'ont pas besoin de subir une irradiation des ganglions. « Nos résultats éclaireront les pratiques en radiothérapie et profiteront aux patientes pour lesquelles l'irradiation ganglionnaire, qui s'accompagne d'effets indésirables comme le gonflement du bras et une limitation des mouvements, peut être évitée », indique le Dr Whelan.
Le début des années 2000 a été marqué par l'émergence de nouvelles technologies informatiques qui ont facilité la mise au point de traitements ciblés, comme l'irradiation partielle du sein, une technique qui concentre l'irradiation sur la zone tumorale sans endommager les tissus sains avoisinants. Avec le soutien des IRSC, l'équipe du Dr Whelan a examiné l'efficacité de cette approche dans le traitement des cancers du sein les moins agressifs.
Dans le cadre de l'essai RAPID (en anglais seulement), son équipe a ainsi démontré qu'une forte dose d'irradiation ciblant la zone tumorale pendant une semaine a la même efficacité qu'une dose normale d'irradiation du sein complet pendant trois à cinq semaines. Si ce traitement accéléré a entraîné moins d'effets indésirables chez les patientes participantes, certaines d'entre elles ont malgré tout signalé des séquelles esthétiques durables du sein.
Dans l'espoir de réduire les conséquences de cette approche sur la santé des patientes, le Dr Whelan réalise l'essai RAPID 2 (en anglais seulement), également financé par les IRSC, et demande aux patientes participantes de signaler les changements esthétiques qu'elles observent pour mesurer les effets du nouveau traitement.
« Notre travail ne consiste pas uniquement à améliorer les chances de survie des patientes et à limiter les effets indésirables des soins prodigués, explique le Dr Whelan. Nous nous efforçons aussi de comprendre ce qu'elles vivent et les associons à la mise au point de nouveaux traitements. »
Au cours de sa longue carrière de chercheur, le Dr Whelan a amélioré les approches suivies en radiothérapie et influé sur les normes de soins du cancer du sein, qui reposent aujourd'hui sur des traitements efficaces, économiques et axés sur les patientes, comme il le décrit lui-même :
« Les patientes qui suivent une radiothérapie accélérée ou un traitement sans radiothérapie signalent peu d'effets indésirables. L'utilisation efficiente des ressources de radiothérapie dans les hôpitaux et les cliniques se traduit par une réduction des dépenses du système de santé pour des traitements évitables qui s'accompagnent quant à eux bien souvent d'effets indésirables. »
C'est gagnant-gagnant.
Le Dr Whelan a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2025 en récompense de ses travaux transformateurs sur l'utilisation de la radiothérapie pour traiter le cancer du sein.
En bref
L'enjeu
La radiothérapie est fréquemment utilisée à l'issue d'une chirurgie mammaire conservatrice chez les patientes touchées par un cancer du sein détecté à un stade précoce afin de réduire le risque de récidive. Les patientes et les soignants s'inquiétaient néanmoins des effets indésirables parfois sévères de l'irradiation.
Recherche
Les travaux du Dr Tim Whelan ont contribué à améliorer l'état de santé des patientes atteintes de cancer du sein et à réduire les effets indésirables de la radiothérapie. Ils ont en outre aidé les hôpitaux et les cliniques à utiliser les ressources de radiothérapie efficacement. Nombre des radiothérapies évaluées par le Dr Whelan sont aujourd'hui normalisées.
- Date de modification :